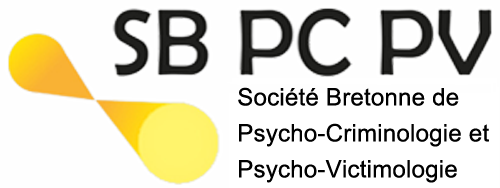Thyma 25/02/2019Publications, Victimologie et Psychotraumatologie
Anne L : victime d’inceste.
Pascal Pignol : psychologue,
Cellule de victimologie, CH Guillaume Régnier, Rennes
Il a fallu du temps pour que ce texte voit le jour, que naisse ce projet commun, que se découvre son sens, sa forme et son style.
Faire-savoir pourrait aussi en être le titre, et cela selon deux essais d’écriture :
- le premier, œuvre de Anne L, victime d’inceste, se présente comme un témoignage composé de fragments d’expériences de vie dont tous ont en commun leur caractère d’insupportable et d’incompréhensible ; sa force tient à ce qu’il se refuse à jouer de la compassion et parvient à faire partager au lecteur par le malaise, sinon de sidération qu’il suscite, ce qu’aucune forme d’émotion commune n’est capable d’approcher ;
- le second, rédigé par un professionnel travaillant dans le cadre d’une consultation spécialisée en victimologie, consiste en un commentaire de ce premier texte, non que celui-ci ne se suffise à lui-même, mais parce qu’il importait d’en tirer des leçons, en l’occurrence de tenter d’analyser ce qui fait encore aujourd’hui bien trop souvent obstacle à la compréhension et à la juste prise en compte de ce qu’est être-victime, ici d’un inceste, notamment la nécessité de développer des modalités de prise en charge, juridiques, sociales et psychologiques spécifiques.
ANNE L : AU SECOURS, Y’ A QUELQU’UN ?
La bascule se fait d’une seconde à l’autre L est arrachée à sa mère. Des gendarmes surviennent pour l’emporter sans rien lui expliquer. Le soir même, elle atterrit dans un commissariat de village. A douze ans, elle doit répondre à des questions visant à lui faire dire l’inceste que son père a perpétré sur elle. Elle répond, elle dit l’inimaginable qu’elle a vécu pourtant sans comprendre la portée de ses paroles. Elle est deux : celle qui était avec sa mère quelques heures auparavant et une autre, une étrangère à elle-même, à qui on extirpe le crime commis. Elle doit parler, sans ménagement, sans explications, sans compréhension, sans le moindre soutien psychologique.
Les gendarmes ne savent pas quoi faire de cette fillette tétanisée, choquée, déchirée.
La nuit suivante, comme les quelques semaines qui suivront, elle la passera dans un hôpital psychiatrique perdu dans les montagnes du département. Personne ne lui apportera là-bas, le moindre soin SPECIFIQUE à sa situation d’incestée. Peu capable de parler, le silence des soignants ne l’incite pas à dire.
L, suite à une décision de justice, est placée chez une tante paternelle, après la déchéance parentale de ses géniteurs. La juge pour enfants a dit à la famille de ne pas lui poser de questions. Elle a treize ans, doit s’adapter à une autre vie, avec des adultes qu’elle ne connaît pas. Elle sombre dans un silence né de l’injonction de la magistrale, qui sera renforcé par le tabou de l’inceste et qui lui forgera au cours du temps une seconde personnalité. Cette absence de mots deviendra vite un refuge et la lecture, avec ses mots écrits, son salut. Elle lit tout et n’importe quoi, partout, toujours.
La juge, par ses ordres de silence, a placée L dans une gangue sans paroles. Elle vit une véritable déchirure, coupée entre son passé et ce présent étranger. Personne jamais ne lui parle, ne tend une perche à des mots qui seraient pourtant nécessaires et bienfaisants.
Alors L se tait, terriblement. Pleure, inlassablement.
L est à présent lycéenne. A dix-huit ans, elle vit seule dans une petite chambre. Elle se gère comme elle peut. Lors de son année de première, elle sèche souvent les cours, d’autant plus facilement qu’elle n’a plus de référent adulte. Elle reçoit des courriers de l’établissement, auxquels elle ne répond pas.
Un matin, elle entend son nom hurler dans les haut-parleurs du préau : mademoiselle Machin est appelée au bureau des CPE. Voici la teneur des reproches qu’on lui adresse : « Vous avez manqué de nombreux cours ce trimestre et vous n’avez même pas la politesse de répondre à nos courriers ». L s’imaginait naïvement que l’institution scolaire se serait enquise de la raison de ses absences, du pourquoi de sa jeune vie en autonomie précoce, des raisons de sa démotivation. Mais non, ce matin-là, elle n’a obtenu qu’une leçon de courtoisie : silence radio entre les murs du bureau.
Malgré les chutes de notes, les absences, les difficultés de concentration, pourtant relevées sur les bulletins, jamais un membre de l’institution scolaire n’a tendu ses oreilles à une parole possible de L, ne l’a sollicitée. A l’inverse, une enseignante lui a asséné un jour cette phrase terrible : « Vous, vous n’aurez jamais votre bac ». Eh bien si, L l’a décroché, son bac, une année où les taux de réussite ont été de soixante pour cent.
L est étudiante, en Lettres Modernes. Sa passion insatiable pour la lecture lui a ouvert les portes de la Fac de Lettres. Elle vient de vivre une relation chaotique avec un garçon. Au début, elle a fait semblant puis très vite, elle n’a plus supporté qu’il la touche. Elle lui a expliqué son histoire. Il est parti. C’est le week-end. Ses quelques amis sont rentrés chez leurs parents. L est seule dans sa chambre d’étudiante. Elle pleure à n’en plus finir. Elle appelle un médecin dont une amie lui a donné les coordonnées. Lors du rendez-vous, elle lui décrit la situation. « On ne peut pas raconter des choses aussi terribles comme ça, ça ne m’étonne pas que votre petit ami soit parti en courant ». L qui cherchait du soutien, repart avec un affreux sentiment où se mêlent étrangeté et culpabilité. Apparemment, elle serait responsable de la fuite de son ami. Apparemment, le remède serait le silence et sa parole, un traumatisme pour ses proches.
L est désormais professeur de Lettres Modernes. Elle traîne toujours cette impression d’être coupée en deux, encore plus depuis qu’elle travaille avec d’autres, des gens normaux qui parlent. De leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs parents, de leur normale vie banale, de ces sujets qui, en les reliant, la délient. On dit d’elle qu’elle est mystérieuse et qu’elle fait preuve de froideur à l’occasion. L ne cherche pas à se distinguer. Simplement elle n’a pas de sujets de conversation communs à partager autour de la machine à café. Vous pouvez dire de votre père qu’il est endetté, qu’il est alcoolique, qu’il est atteint d’une maladie incurable, qu’il vous a frappé même, mais vous ne dites pas de votre père qu’il est incestueux (combien le mot « incestueur » serait opportun !). Donc L se ferme sur de nombreux sujets et passe pour une prof un peu fière, qui aime entretenir le mystère.
Un jour, au boulot, n’en pouvant plus de ne pouvoir se raconter, elle a tenté d’échanger avec une collègue autour de ses traumatismes familiaux, histoire de délester quelque peu son fardeau. Peine perdue : on lui a fait comprendre que certains sujets s’abordaient chez le psy et on l’a éconduite. Quelques mois après, L a eu un problème de santé, qu’elle a cru grave. Elle en a parlé à cette même personne qui s’est montrée toutes oreilles dehors « Les ennuis de santé, c’est pas pareil, ça peut arriver à tout le monde ». Le passé de L n’a pas droit de cité autour de la machine à café.
Après le boulot L se distrait parfois en faisant de la couture : elle a ainsi confectionné une housse de canapé avec un tissu longuement choisi, qu’elle a orné d’un motif en coton bleu. Ce travail lui a pris des heures. Elle n’en a tiré, malgré les compliments reçus, aucune fierté : L ne sait pas ce dont il s’agit. Face aux compliments, elle se fait passoire. Faut dire qu’on n’a jamais beaucoup flatté son égo.
L, dans sa quête de guérison, a longtemps cherché des groupes de parole de victimes d’inceste. Tâche ardue s’il en fut. Elle a frappé un jour à la porte d’un Planning familial. On lui a indiqué un groupe de paroles de victimes de violences sexuelles. Or L cherchait un dispositif particulier pour victimes d’inceste. Son interlocutrice lui a rétorqué que les séquelles étaient similaires et qu’il n’était pas judicieux d’établir de comparaisons. C’est ainsi que L est repartie déçue et mal à l’aise, lestée d’un nouveau fardeau, celui d’une culpabilité tout juste héritée : L considèrerait à tort que l’inceste crée plus de souffrances que le viol « classique ». L ne pense pas ainsi. Elle aimerait simplement qu’on reconnaisse aux incestées des troubles spécifiques afin de rendre possible une GUERISON.
L’insomnie et sa jumelle, l’angoisse, sont devenues pour L de fidèles compagnes de soirée. Peur du lendemain, de ne pas assumer, peur de ne pas se réveiller, peur des cauchemars atroces qui terrorisent ses nuits, peur du cortège d’idées noires au réveil, autant de pieuvres qui lui vrillent le cerveau quand d’autres savourent le sommeil. Pas grave, L a sa trousse de médicaments, à portée de main. De toutes façons, y a plein de gens qui ont des problèmes pour dormir, c’est banal, dit son médecin.
Une pieuvre tenace : la terreur du secret révélé. Contorsionnée dans son lit, L compte les personnes à qui elle a raconté son histoire : leur nombre, tout faible soit-il, la terrorise. Son cerveau s’affole sous l’attaque de scénarios interminables et absurdes. Et si sa collègue allait dire ça au principal de son collège ? Et s’il la virait ? Et si les élèves savaient ? Et si les parents l’apprenaient ? Et si, si, si ??? Scénarios de démolition programmée dont aura raison une auto thérapie : cachets clopes…
Au cours de ses lectures, L a un jour lu ceci : les victimes d’inceste ont une espérance de vie qui peut être réduite jusqu’à vingt ans par rapport à la population de base. Ça lui a fait un sacré choc.
L, à bout de souffrances, a connu deux longues hospitalisations en milieu psychiatrique. Pas une fois on ne lui a proposé de traitement approprié à ses troubles. Une infirmière s’en est même excusée. Finalement, comme on ne lui parle jamais de sa pathologie spécifique, L se croit malade imaginaire. C’est comme si L, ses séquelles spécifiques et son passé, n’avaient pas de véritable existence. D’ailleurs, comment pourrait-on traiter une pathologie que l’on n’identifie pas ?
En écrivant, L souhaite que son histoire personnelle serve un but collectif, forme un pont entre les victimes. Or, un psychiatre auquel elle s’est confiée, après lecture du texte, lui assène cette phrase autoritaire : « Vous écrivez pour vous, parce que c’est nécessaire. Aussi poignant soit-il, ça n’est qu’un témoignage personnel ». L y réfléchira à deux fois avant de livrer ses écrits à un interlocuteur « compétent ». Elle est disposée à accepter la critique, pas l’oblitération des enjeux de son écriture.
Certains hivers L a la grippe. Elle note ses symptômes, se rend chez le médecin qui établit un diagnostic et lui donne un traitement.
Certains soirs L sombre dans un désespoir aigu, agressif, qui la ronge jusqu’à l’âme. Elle ne sait à quelle porte frapper. Appeler une amie en pleine nuit, déranger les pompiers ? Allez, deux ou trois cachetons de plus, et ça ira mieux demain…
Des médocs, L en a ingurgité des paquets, depuis son adolescence, pour dormir le soir, pour un peu de joie artificielle le matin, pour neutraliser l’anxiété le jour : des pseudo- pansements qui ne guérissent pas. Un jour d’août, elle s’est rendue d’urgence dans un CMP car une terrible nouvelle venait d’affecter sa famille. Elle souhaitait de l’aide humaine. Réflexe immédiat de l’infirmière : « Vous avez un traitement ? On peut voir avec le psychiatre et l’adapter… L a refusé. Ce n’est pas ce qu’elle était venue chercher…
L ne voit pas la vie comme une ordonnance infinie.
Combien de fois L a-t-elle entendu cette phrase ? « Mais ça fait longtemps, t’étais enfant, maintenant tu as vingt ans (ou trente, quarante, cinquante, selon…). Passes à autre chose ». Ces amis, médecins, psychologues, qui vous veulent du bien… L n’a jamais vu de date de péremption sur ses bagages douloureux.
Si la souffrance est désormais à obsolescence programmée, prière de la mettre au courant…
COMMENTAIRES : LES EFFETS DELETERES DES DESAVEUX
Sommes-nous sortis de l’ère de la suspicion à l’égard des victimes et entrés, comme le soutiennent Fassin et Rechtman (2007), dans celle d’une reconnaissance généralisée des dommages engendrés par toutes formes de violences ? Il s’agit incontestablement d’une tendance profonde émergeant au 19ièmesiècle dans les sociétés occidentales (Pignol, 2011), mais elle ne va pas sans susciter des résistances multiples. Certes la prise en compte des victimes commence d’inspirer des politiques en leur faveur mais ces fragmentsmontrent encore quel chemin reste à parcourir, en particulier chez les professionnels et les institutions en premier lieu concernés. L’on peut même se demander si nous ne nous trouvons aujourd’hui dans une période active de résistance à leur développement, comme semblent en attester, entre autres choses, le fait que l’inceste (comme les violences conjugales) ne puisse toujours pas véritablement figurer comme tel dans le code pénal, ou encore la difficulté à décider d’une présomption de non consentement en cas de pénétration sexuelle sur un mineur.
DESAVEUX ET TRAUMAS SECONDS
L’on a beau jeu, encore aujourd’hui, de s’étonner, quand ce n’est pas de leur en faire le reproche, que les victimes n’aient pas parlé de ce qu’elles avaient subi, ou bien trop tardivement pour en être crédibles. C’est méconnaitre les raisons de leur silence, qui est souvent pour un temps plus ou moins long la moins pire des solutions, une forme de protection si ce n’est une véritable stratégie de survie psychique et sociale. C’est méconnaitre encore le fait qu’elles aient souvent parlé et que ce silence qui leur est reproché n’est souvent que l’écho de la surdité à laquelle elles avaient pu se heurter : ce silence-là n’est pas le leur mais celui des personnes ou des institutions à laquelle elles ont en vain tenté de s’adresser.
Bien qu’ils fassent encore l’objet de trop rares réflexions théoriques et cliniques, les effets dévastateurs de telles surdités et ont été depuis longtemps décrits. Avec une notion profondément originale, celle de « désaveu », le psychanalyste hongrois Sandor Ferenczi avait mis en lumière l’importance des réactions négatives de l’autre parent aux allégations d’agressions sexuelles de l’enfant, faisant de celles-ci un facteur traumatique à part entière, au moins aussi important que les violences sexuelles et éducatives elles-mêmes. Il pouvait écrire en 1931 : « Le pire, c’est vraiment le désaveu, l’affirmation qu’il ne s’est rien passé, qu’on n’a pas eu mal, ou même d’être battu et grondé lorsque se manifeste la paralysie traumatique de la pensée ou des mouvements ; c’est cela surtout qui rend le traumatisme pathogène ».
Plus récemment, sous le terme de « traumatisme second », C. Barrois (1988) développera des considérations très proches, et fera un facteur traumatique de toutes les réactions négatives auxquelles peut se heurter une victime de la part non seulement de son entourage mais aussi de la société dans son ensemble : « Ce traumatisme second est la répétition, sans sa soudaineté, de la solitude, de la déréliction et de la détresse du sujet, qui se trouve non plus seul, dans sa solitude absolue devant la perspective désespérée de sa propre mort (ou de son équivalent), comme le traumatisme psychique fondateur, mais au sein même de sa collectivité, absolument seul, malgré la présence des autres. ». Ce qui peut être à l’origine de ce traumatisme second, c’est la confrontation du victimé à toutes les réactions négatives auxquelles il peut se heurter : indifférence, hostilité, soupçon de simulation, incompréhension, culpabilisation… Les conséquences observables en sont une rechute ou une aggravation des troubles.
TRAUMA, DESAVEUX, AUTO-DESAVEUX
Contre les thèses freudiennes, Ferenczi en viendra au plan métapsychologique à devoir réhabiliter « l’importance du traumatisme et en particulier du traumatisme sexuel comme facteur pathogène » (1938). Et il décrira de façon affinée les conséquences psychiques très particulières de tels abus, bien différentes du refoulement névrotique. La fragmentation psychique qui résulte de la violence, conjuguée aux effets des désaveux qui peuvent être opposés à la reconnaissance de sa réalité, aura notamment des effets directs sur sa représentation possible : « Si l’enfant se remet d’une telle agression… sa confiance dans le témoignage de ses propres sens est brisée » (1935). L’on trouve chez Ferenczi de nombreuses formules pour dire la catastrophe intime qu’engendrent violences sexuelles et éducatives, ainsi que les modalités d’aménagements internes qu’elles nécessitent pour y survivre. Des notions novatrices se veulent en rendre compte, en particulier celle d’ « identification à l’agresseur » dont il faudrait mieux dire qu’elle est une « introjection » de force de sa responsabilité, dès lors endossée par un enfant devenu à la fois « innocent et coupable » ; introjection car l’on connait maintenant mieux les « stratégies de décriminalisation » déployées par un agresseur affirmant son impunité (Villerbu, 2017) et qui peuvent faire l’objet d’une semblable incorporation par l’enfant abusé, et aussi par l’entourage. L’on pensera également à la différenciation faite entre défenses alloplastiques et défenses autoplastiques, toujours aussi éclairante tant la clinique victimologique en fournit des exemples au quotidien.
Traumatismes et désaveux conjugués se font ainsi auto-désaveux (se nier soi-même comme victime), véritables modalités d’adaptation de survie formées au prix d’un ajustement des repères internes au « système agresseur » d’un sujet en désaveu de lui-même, de ses sens, de ses éprouvés, et de sa souffrance ; métamorphose en une conscience coupable et responsable, sans plus aucun auteur ni victime, sans plus même de violence. L’on commence à peine à en mesurer les conséquences multiples au long cours, en termes de vulnérabilités psychiques, physiques, relationnelles, sociales, responsables de parcours d’existence chaotiques et de modes de vie problématiques, et exposant notamment à de nouvelles victimisations.
DESAVEUX DISCIPLINAIRES ET PROFESSIONNELS
Parmi les modalités de désaveu les plus destructrices auxquelles peuvent se heurter les sujets victimes il est celles que peuvent leur opposer les professionnels de tous domaines. Des écrits des premières féministes à des travaux contemporains, comme ceux de G. Lopez (2013) ou encore de M. Salmona (2018) dénonçant le déni généralisé des violences sexuelles et des maltraitances sur les enfants, l’histoire est faite des résistances du monde médico-psychologique à prendre la mesure des retombées singulières des violences sexuelles sur leurs victimes.
Ferenczi, encore lui, avait en son temps dénoncé certains aspects de la situation analytique allant totalement à l’encontre de sa visée thérapeutique car ils avaient pour le patient valeur d’une véritable répétition du trauma : « La situation analytique… ne diffère pas essentiellement de l’état de choses qui autrefois, c’est-à-dire dans l’enfance, l’avait rendu malade » (1938). Et l’on connait les effets dramatiques de la généralisation de la thèse de l’après-coup freudien à toutes situations cliniques, conduisant à ne questionner que les échos inconscients qu’a pu avoir une violence, sans prise en compte effective de la réalité de celle-ci et de ses effets destructeurs (Lopez, 2013).
Ces postions non discutées conduiront chez certains à une forme d’hégémonie de la pensée thérapeutique, tout particulièrement dans le domaine de l’enfance. C’est incontestablement là que peuvent s’observer les antagonismes les plus radicaux, selon la priorité accordée soit à la dimension juridique au nom de la protection de l’enfant, soit à la dimension « thérapeutique » au nom du devenir psychique de celui-ci. Partant, deux positions psy s’y affrontent selon qu’est mis en avant un impératif psychothérapeutique pour lequel le processus judiciaire constitue un obstacle ou à tout le moins une gêne, ou un impératif de signalement et de protection sans lesquels l’intervention psy sera jugée complice passive des maltraitances (Nisse et Sabourin, 2004).
Nous voudrions ajouter à cette histoire d’un désaveu scientifique généralisé un chapitre moins mentionné et qui pourtant a eu des effets profonds jusque récemment, selon P. Le Maléfan (2006) et, peut-on penser, encore aujourd’hui sous formes renouvelées. Il s’agit de la théorie de la mythomanie d’E Dupré, psychiatre et médecin légiste. Elle remonte à 1905. Par le terme de mythomanie, Dupré désignait « la tendance pathologique, plus ou moins volontaire et consciente, au mensonge et à la création de fables imaginaires », « …tendance constitutionnelle qui pousse certaines catégories d’individus à mentir, à simuler et à inventer, par l’activité pathologique de l’imagination créatrice, des fables et des situations dépourvues de réalité objective sous forme, soit de récits oraux ou écrits, soit de simulations d’états organiques anormaux, qu’on peut considérer comme mensonges objectifs ». Elle se retrouve chez tous les enfants, en raison de leur immaturité physiologique mais aussi de leur extrême suggestibilité. Le texte de Dupré se conclut tout « naturellement » par un ensemble de recommandations médico-légales à destination des experts : « Le témoignage de l’enfant doit toujours être considéré, sinon comme irrecevable, au moins comme extrêmement suspect, et n’être accepté que sous bénéfice d’inventaire et de contrôle… On doit toujours rechercher, chez l’enfant, les éléments de la suggestion étrangère, volontaire ou involontaire, de la part de l’entourage : parents, maîtres, etc. Les magistrats ne devraient, en aucun cas, accorder au témoignage de l’enfant, une valeur effective ou morale que celui-ci ne peut comporter ; et le devoir du médecin-légiste est d’éclairer les magistrats sur le peu de valeur probante que comportent, à toutes les phases de la juridiction, les témoignages ou les renseignements émanés de l’enfant ».
Désaveu exemplaire s’il en est, en ce qu’il montre a contrarioque la reconnaissance des violences faites aux enfants ne peut aller sans une mise en question de nos normes et valeurs collectives, ici relatives à l’autorité parentale et au statut de l’enfant. La mythomanie de Dupré en effet participait d’un mouvement de réaction aux textes de loi de 1889 et 1898 restreignant l’autorité paternelle en rendant notamment possible sa déchéance en cas de mauvais traitements sur l’enfant (Vigarello, 2005). Quant aux violences à caractère sexuel, les travaux historiques de G. Vigarello (2000) montrent tout le chemin qu’il a fallu parcourir pour leur reconnaissance, contre notamment l’importance longtemps accordée à l’honorabilité des protagonistes aux dépens des faits eux-mêmes. Il faudra également que s’ouvre une réflexion de fond sur ce qu’est le consentement, dont l’actualité montre à quel point elle reste sur de nombreux points encore à développer.
TEMOIGNER
A supposer réunies conditions les plus favorables possibles au recueil de la parole des victimes, quand bien même elle ne se verrait opposer aucun désaveu, tout ne saurait être résolu pour autant.
Tout témoignage, quelle que soit sa forme, se heurte ainsi à un véritable dilemme : dire l’indicible. Dire au prix d’un risque de réduction aux catégories communes de l’expérience qui lui fait perdre ce qui en est le propre, à savoir son caractère extrême, sidérant à en demeurer ineffable ; se taire au risque de la déréliction, d’un récit intérieur qui ne parvienne pas à se constituer comme tel et conserve entier le pouvoir délétère de la violence.
A minima, pour qu’une violence puisse être désignée comme telle, il faut au moins qu’elle trouve dans le champ social, médical, psychologique, juridique…, une inscription possible, c’est-à-dire un ensemble de signifiants collectifs à la mesure de sa nature et de sa gravité. L’émergence récente de la notion de harcèlement (au travail, dans le couple, à l’école…) est à cet égard exemplaire dans la mesure où elle a permis à beaucoup de circonscrire, désigner et donner forme et signification à des situations vécues jusqu’alors hors toute appréhension possible.
PENSER D’AUTRES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Ferenczi, toujours lui, prendra la pleine mesuredu poids des désaveux dans les problématiques psychotraumatiques et il fera de la reconnaissance par le thérapeute de la réalité des violences subies une condition première, fondamentale. Ainsi : « Il apparait que les patients ne peuvent pas croire, ou pas complètement, à la réalité d’un événement, si l’analyste, seul témoin de ce qui s’est passé, maintient son attitude froide, sans affect et comme les patients aiment à le dire, purement intellectuelle, tandis que les événements sont d’une telle nature qu’ils doivent évoquer en toute personne présente des sentiments et des réactions de révolte, d’angoisse, de terreur, de vengeance, de deuil et d’apporter une aide rapide, pour éliminer ou détruire la cause ou le responsable » (2006).
Il est souvent opposé que le travail psychothérapique ne saurait avoir pour objet de chercher à déterminer si ce que le patient dit est vrai, qu’il s’agirait d’entendre sa souffrance sans jamais prendre parti sur la nature réelle ou fantasmatique de ce dont il témoigne et que, s’il est effectivement victime, ce ne peut être qu’à la justice d’en décider. Or il ne s’agit pas chez Ferenczi de vérifier ce qui peut être évoqué par le patient, les traces psychiques si singulières laissées par les violences ainsi que le positionnement transférentiel dans la situation thérapeutique (en particulier la crainte omniprésente de ne pas être cru) se suffisant à eux-mêmes.
Création d’espaces spécifiques comme des consultations spécialisées en milieu ouvert et en milieux hospitaliers (Pignol et Galinand, 2016), modalités d’accueil et de recueil de ce dont les victimes peuvent encore témoigner, recherche d’étayages sur des représentations collectives ainsi que sur d’autres témoignages dans un travail de groupe de pairs victimes des mêmes formes de violence, constituent les conditions minimales d’un tel accompagnement. Celui-ci visera en premier lieu : – à comprendre ce que fut ou est encore la situation victimale, ses effets destructeurs, les désaveux multiples qui ont pu lui être opposés ; – à en rechercher et concevoir des représentations et des mises en forme et en récits qui puissent à la fois en dire l’anormalité fondamentale et les valeurs collectives et restauratrices qui puissent leur être opposées.
BIBLIOGRAPHIE
- Barrois C. (1998) : Le traumatisme second, Méd.-Psychol.1998 ; 156, (7) ; 487-92.
- Dupré E. (1905) :La Mythomanie, étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides, Clinique des maladies mentales. Institut de médecine légale et de psychiatrie, Paris.
- Fassin D., Rechtman R. (2007) : L’empire du traumatisme, Paris, Flammarion.
- Ferenczi S. (1931) : Analyse d’enfants avec des adultes. In Psychanalyse IV, Paris, Payot ; 1999.
- Ferenczi S. (1938) : Confusion de langue entre les adultes et l’enfant, Paris, Petite bibliothèque Payot (2004).
- Ferenczi S. (2006) : Le traumatisme, Paris, Petite bibliothèque Payot.
- Le Malefan P. (2006) : Dupré, père de l’enfant menteur appelé aussi mythomane ou un trouble des conduites au temps de la doctrine des constitutions, L’évolution Psychiatrique, 71, p. 447-469.
- Lopez G. (2013) : Enfants violés et violentés. Le scandale ignoré. Paris, Dunod.
- Nisse M, Sabourin P. (2004) : Quand la famille marche sur la tête,Paris, Le Seuil.
- Pignol P. (2011) : Le travail psychique de victime. Essai de psycho-victimologie. Doctorat d’Etat, Université de Rennes2.
- Pignol P., Galinand G. (2016) : 15 ans d’expérience d’une consultation spécialisée en victimologie au CH Guillaume Régnier de Rennes, L’information psychiatrique, 92, p. 151-62.
- Salmona M. (2018) : Le livre noir des violences sexuelles, 2ièmeéd., Paris, Dunod.
- Vigarello G. (2000) : Histoire du viol, Paris, Le Seuil.
- Vigarello G. (2005) : L’intolérable de la maltraitance infantile. In D. Fassin et P. Bourdelais, Les constructions de l’intolérable. Etudes d’anthropologie et d’histoire sur les frontières de l’espace moral, 112-127, Paris, La Découverte.
- Villerbu L-M. (2017) : Impunité et punitivité. Dossier « Sortir de l’impunité », Les Cahiers de la Justice, 2017/1, 55-64